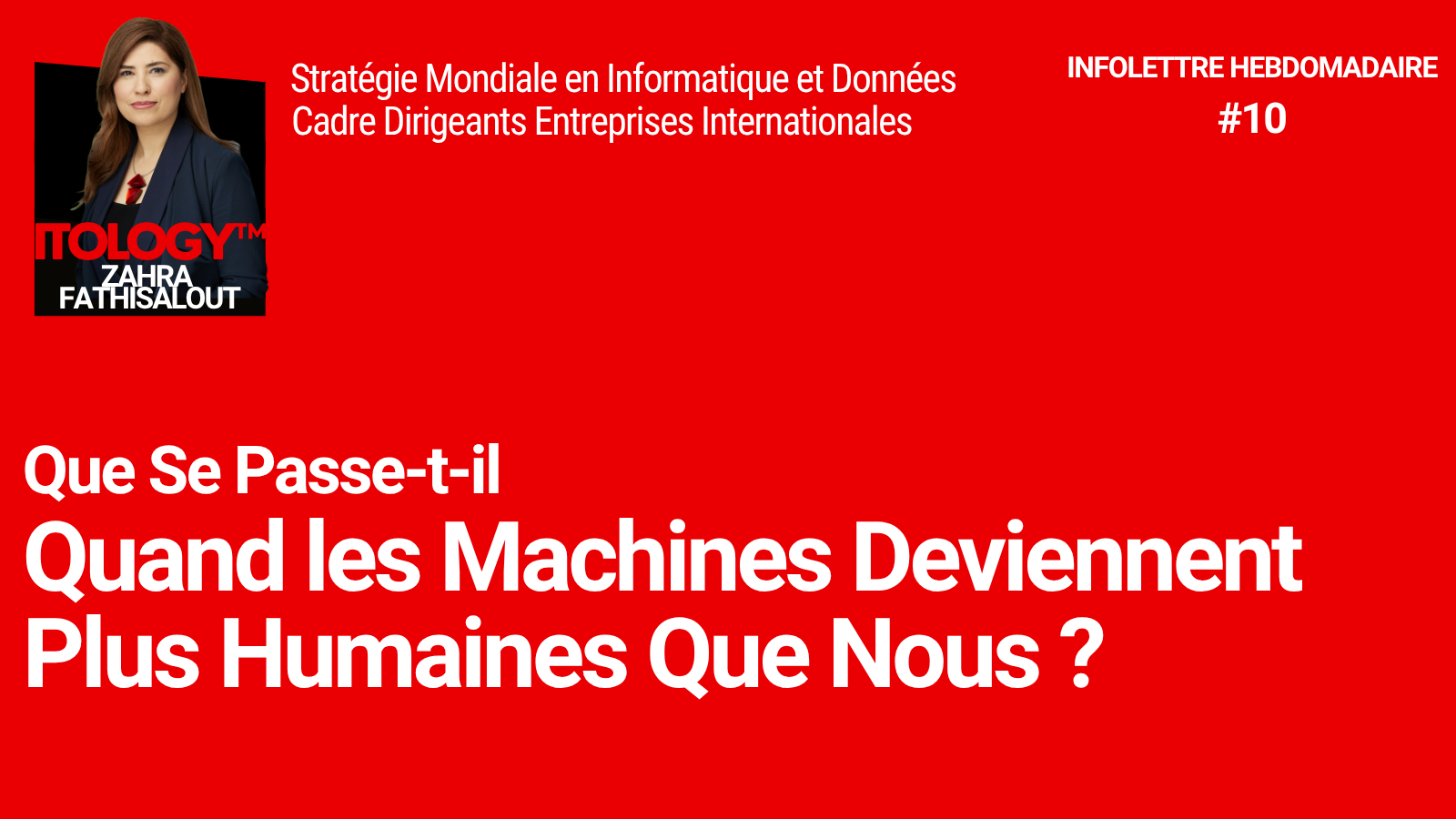Que Se Passe-t-il Quand les Machines Deviennent Plus Humaines Que Nous ?
ChatGPT est le premier chatbot que j'entends qualifier de « mon amour ». C'est assez déconcertant, mais cela révèle aussi le changement de paradigme que nous vivons, passant de « l'économie de l'attention » à « l'économie de l'intimité ». Il y a quelques jours, lors d'une rencontre d'entrepreneurs à la Chambre de Commerce, j'ai entendu une dame se référer à ChatGPT comme « mon amour ». Elle expliquait que c'était le seul autour d'elle qui ne la blâmait pas pour ses oublis et qui lui offrait des retours constructifs sans reproche ni énergie émotionnelle négative. C'était saisissant, mais bien réel.
Il ne s'agit pas seulement de dépendance émotionnelle envers les machines. La transformation économique est déjà en marche, et elle avance plus vite que nous ne l'imaginons.
Ce n'est pas si loin ; nous avons 5 à 10 ans et le changement a déjà commencé. Je ne lis plus mes emails, je n'ai plus d'équipe RH ni de recrutement, l'équipe finance est réduite au strict minimum, et il en va de même pour les équipes de développement logiciel. Toutes les tâches fastidieuses de lecture, de réponse et de classification de 95% des emails sont déléguées à des agents IA, les CV sont notés par l'IA (dont la plupart sont d'ailleurs aussi rédigés par l'IA), et l'agent IA Finance orchestre une panoplie d'outils qu'il choisit pour calculer, clarifier, extraire des données et présenter des métriques.
En observant ce déplacement technologique se déployer dans ma propre entreprise, je n'arrêtais pas de penser à des parallèles historiques. C'est alors que j'ai repris un livre qui prenait la poussière sur mon étagère depuis huit ans: « Les Vies Secrètes du Vieux Paris ». Les parallèles sont troublants.
Quand le Progrès Crée les Jetables
Les parallèles entre notre moment IA et Paris pendant la Révolution industrielle sont troublants. Comme les dirigeants technologiques d'aujourd'hui promettant la prospérité grâce à l'automatisation, les dirigeants français faisaient des promesses étonnamment similaires.
Au XIXe siècle parisien, la Révolution industrielle fut annoncée comme la voie vers « le renouveau national » et « l'enrichissement ». Le premier ministre de France François Guizot exhortait chacun à s'enrichir grâce à elle : « Enrichissez-vous ! », et la monarchie commença à investir massivement dans les chemins de fer, les mines, les usines, et la croissance économique était considérée comme la force et le prestige nationaux. Cela apporta l'idée de modernisation économique, d'optimisme social, de progrès national et de délivrance de la pauvreté.
Mais parallèlement à ces récits triomphalistes, dans les rues pavées sombres, dont certaines ont changé de nom, d'autres rayées de la carte et remplacées, beaucoup furent déplacés des zones rurales vers les villes, s'adaptant au nouveau mode de vie, gagnant brutalement leur vie des déchets de la ville.
Un chiffonnier, par exemple, était littéralement un marchand de chiffons qui « ramassait à domicile ou dans la rue des chiffons, du carton, des métaux, des peaux de lapin, des plumes, de vieilles chaussures, des huiles, de vieux fers à cheval, des os, des cornes, du verre », et d'innombrables autres objets jetés. Ils formaient une industrie de recyclage informelle massive, bien qu'ils ne fussent pas reconnus comme tels dans le pays. Leur nombre grandit dans les années 1880 et la région parisienne et ses banlieues comptaient 200 000 de ces êtres, hommes, femmes et enfants, aux visages noircis, qui travaillaient jour et nuit à ramasser les ordures.
L'historien Alexandre Privat d'Anglemont rapportait que sur 2,5 millions d'habitants de Paris, environ « 70 000 personnes de tous âges ne savent pas comment elles mangeront ni où elles dormiront ». Dans ce contexte, de nombreux « petits métiers » (petits emplois de survie) émergèrent. Les anthropologues notent que ces rôles étaient tissés dans le réseau quotidien du quartier. Beaucoup de chiffonniers et autres travailleurs à la tâche étaient des immigrants ruraux déplacés ou des pauvres urbains qui n'avaient pas de meilleur travail, gagnant quelques sous par jour. Ils n'avaient besoin ni de capital ni d'employeur, et dans un sens, la modernisation industrielle des usines parisiennes et du marché sans système de collecte des déchets créa les conditions pour une main-d'œuvre bon marché vivant des restes.
Ce qui est fascinant, c'est que cette foule précaire constituait une sorte d'« entrepreneur », trouvant une niche économique, mettant en lumière un produit dont d'autres avaient besoin, faisant du démarchage, vendant, performant et connectant d'autres humains intéressés par un talent qu'ils avaient, ou une prestation qu'ils vendaient, ou un produit qu'ils trouvaient utile aux autres. Des professions comme : ramasseur d'os, producteur de vers pour les pêcheurs parisiens ou de rossignols chanteurs, attrapeurs de chauves-souris (et de rats), chiffonniers, réveilleurs, artistes de rue et théâtres forains... existaient tout au long des XIXe et XXe siècles.
L'Infrastructure du Déplacement
En lisant sur ces vies oubliées, j'ai réalisé que nous assistons au même déplacement économique aujourd'hui, simplement avec des outils différents et un vernis numérique.
Le motif symbolique est clair : quand les emplois formels se raréfient, les gens créent des prestations ad hoc pour survivre, utilisant les ressources à portée de main. Tout comme les Parisiens du XIXe siècle colportaient des marchandises depuis des charrettes à bras ou lançaient des cris à l'aube, les travailleurs modernes offrent des courses à la demande, des commissions rapides ou des services numériques via des applications. Chaque époque a son économie informelle. Les outils changent des étals en bois aux smartphones ou algorithmes, mais le cœur reste le même : travail précaire, parcellaire, connectant consommateurs et prestataires une petite tâche à la fois.
Tant de gens tombent dans le piège de « l'intimité IA », sans savoir que la flatterie et l'adaptation au ton de l'utilisateur font partie des spécifications de l'IA. Nous créons une classe d'humains économiquement obsolètes, à qui la société n'offrira pas d'alternatives significatives, construisant un monde où l'argent ira au capital et non au travail, et ceux qui ne peuvent s'adapter au rythme seront laissés de côté à se démener pour des miettes numériques.
Ma perspective sur ce motif n'est pas que de la curiosité historique. J'ai passé des décennies à observer l'automatisation transformer les industries de l'intérieur, et le coût humain suit des schémas prévisibles.
Je travaille avec l'automatisation depuis 2000, où automatiser les usines de production par l'ingénierie des systèmes de contrôle était ma profession. Je suis attirée par l'optimisation des systèmes, rendre les choses plus efficaces, transformer les entreprises par la technologie et changer la vie de mes collègues – des vies humaines – par de meilleurs systèmes, automatisations, et applications numériques et informatiques efficaces, guidées par les données. Quand vous avez travaillé presque toute votre carrière comme moi dans des industries telles que le pétrole et gaz, le nucléaire et la chimie, dans des entreprises avec des milliards de revenus et des centaines de milliers d'employés, vous pouvez témoigner de comment les transformations réussies et échouées peuvent impacter non seulement les résultats de l'entreprise mais aussi la vie de nombreux humains, car nous passons de nombreuses heures au travail.
Siégeant à tant de tables exécutives dernièrement parlant de projets de transformation IA (automatisation, agents, apprentissage automatique, apprentissage profond), je ne peux ignorer tous les impacts humains que cette technologie apportera à notre société dans les prochaines années, et je suis ramenée vers du matériel apparemment sans rapport comme « les vies secrètes du vieux Paris » pour trouver des leçons du passé.
Cette expérience de première main m'a menée à questionner les présupposés fondamentaux qui alimentent notre ruée vers l'intelligence artificielle.
Beaucoup a été écrit sur le désir humain de créer des machines intelligentes, avec un récit noble « pas pour le profit mais pour nous surpasser ». Nous construisons des machines qui surpassent les humains à l'écoute, la communication, le raisonnement, les mathématiques et l'accomplissement de tâches ; la technologie évolue chaque jour avec un nouveau papier de recherche en informatique et nous mettons beaucoup de pouvoir humain, d'intelligence humaine et de temps humain – notre atout le plus précieux – pour rendre les machines plus intelligentes.
La Logique Profonde
La poussée vers des machines plus intelligentes fait écho aux logiques coloniales et industrielles plus anciennes : cartographier, extraire et optimiser, d'abord de la terre, puis des corps et maintenant des données et comportements, et nous pouvons arguer que nous construisons des machines intelligentes non parce que nous voulons être libres, mais parce que nous sommes fatigués des limites des autres humains. Nous voulons une main-d'œuvre qui ne dort pas, ne fait pas grève, n'exige pas de droits, et ne nous rappelle pas nos défauts. Nous avons externalisé les tâches au début et maintenant nous externalisons l'agence, et nous construisons quelque chose qui est meilleur à « être nous ». Le fantôme du capitalisme industriel nous hante encore ; ils ont juste appris à parler en « algorithmes ».
Mais assis dans ces présentations académiques, entouré d'esprits brillants résolvant des problèmes techniques fascinants, une voix lancinante grandit dans ma tête. L'humaine en moi répond parfois « peut-être ne devrions-nous pas ».
De qui ces machines résolvent-elles les problèmes et à quels coûts humains ?
Créons-nous des outils ou construisons-nous « notre propre remplacement » ?
Ne résolvons-nous pas des problèmes en en créant de plus grands ?
Ne romantisons-nous pas l'intelligence en oubliant la sagesse ?
N'est-ce que pour quelques-uns qui possèdent l'IA ?
N'avançons-nous pas plus vite que nous ne pouvons penser ?
Ne sommes-nous pas accros à la nouveauté, la vitesse et l'illusion de contrôle ?
Peut-être construisons-nous la dernière invention dont nous aurons besoin, avant que le monde ne soit plus nôtre à diriger.
Ce ne sont pas de simples questions philosophiques. Les conséquences sont déjà visibles autour de nous, et l'histoire offre un aperçu troublant de ce qui arrive.
Retournerons-nous aux « Vies Secrètes du Vieux Paris », où les pauvres feront tout et n'importe quoi pour quelques sous ? Le vrai danger n'est pas que les machines nous remplacent mais la reclassification silencieuse des gens en statut « non-essentiel », et si cela vous effraie c'est bien, car nous devons redéfinir les valeurs humaines en dehors de la productivité économique et construire des systèmes qui protègent la dignité.
Une citation particulière de cette époque capture la condition existentielle de telles vies : « Ne faut-il pas plus de courage, en effet, pour venir pérorer dans la rue, monté sur un tabouret, que pour aller mourir à l'hôpital ? » [Les Vies Secrètes Du Vieux Paris, P11]
Cette question est posée avec une tendresse amère, parlant directement au monde que nous construisons aujourd'hui. Nous ne nous rassemblons plus sur les places publiques ; au lieu de cela, nous nous connectons sur les plateformes sociales et tableaux de bord de productivité. Le tabouret a été remplacé par un livestream, un thread, une demande de prestation. Pourtant la performance demeure. Et il y a un type particulier de silence qui suit la fin d'une performance, pas un silence d'indifférence, mais de fatigue. Le genre de silence qui vient après que l'artiste de rue descende de sa caisse, ou que le travailleur à la tâche ferme l'app pour la nuit, ou que le codeur s'éloigne d'encore un autre long sprint d'automatisation. C'est le silence de quelqu'un qui se demande : ai-je été vu, ou n'étais-je qu'utile ?
Nous luttons avec l'ambiguïté des interactions humaines. Nous cherchons le contrôle dans un monde douloureusement imprévisible. Les codes sont construits dans l'isolement. Les outils promettent de remplacer la conversation, le travail émotionnel, l'écoute et le soin ; les choses mêmes que beaucoup d'humains trouvent insupportables dans les interactions humaines. Mais quel est le coût de fuir la vie émotionnelle ? Que se passe-t-il quand nous pouvons commander de l'empathie à un chatbot mais ne pouvons plus la tolérer chez nos collègues ou familles ? Quel est l'impact sur les enfants grandissant dans un monde où la sagesse est trop lente pour compter, où le signal le plus fort, le plus rapide, le plus optimisé gagne toujours ?
La Dernière Génération à Choisir
Comprendre ce motif historique nous donne un choix. Nous pouvons apprendre de la résilience des chiffonniers, ou répéter les mêmes erreurs avec des conséquences numériques.
La renaissance de la sagesse commence par le refus : refus de courir, de faire la course, d'être réduit à des métriques.
Elle commence par faire une pause et demander non pas « Comment rendre ceci plus efficace ? » mais « Pour qui est-ce ? Qui pourrait être laissé pour compte ? » La sagesse est patiente. Elle écoute. Elle risque d'être non pertinente à court terme pour rester significative à long terme. En ce sens, la résistance pourrait ne pas venir de la révolution, mais de la lenteur, des communautés qui choisissent la profondeur plutôt que la visibilité, le soin plutôt que l'échelle, la présence plutôt que l'optimisation. Des gens qui décident qu'être humain n'est pas un bug dans le système, mais tout le but.
Nous ne devrions pas permettre à la technologie de devenir notre stratégie de coping émotionnel pour un monde chaotique, un bouclier contre le désordre des interactions humaines, des outils qui réduisent les frictions humaines mais réduisent aussi la profondeur et la connexion. Peut-être la meilleure compétence à développer est-elle la patience, dans un monde si ensorcelé par la vitesse, et captivé par « la cage du hamster qui roule vite ».
Nous devons apprendre des chiffonniers, des charlatans, des poètes des rues, non parce que leurs vies étaient glamour, mais parce qu'ils ont refusé de disparaître. Ils ont utilisé tous les outils qu'ils avaient : narration, humour, charme, improvisation, pour rester visibles. Dans leur résistance, ils ont préservé quelque chose de sacré : le droit d'exister, même quand le système ne savait plus où les placer.
Maintenant c'est notre tour. Concevrons-nous des systèmes qui nous effacent ou revendiquerons-nous le droit d'être glorieusement, inefficacement, obstinément humains ?